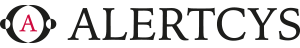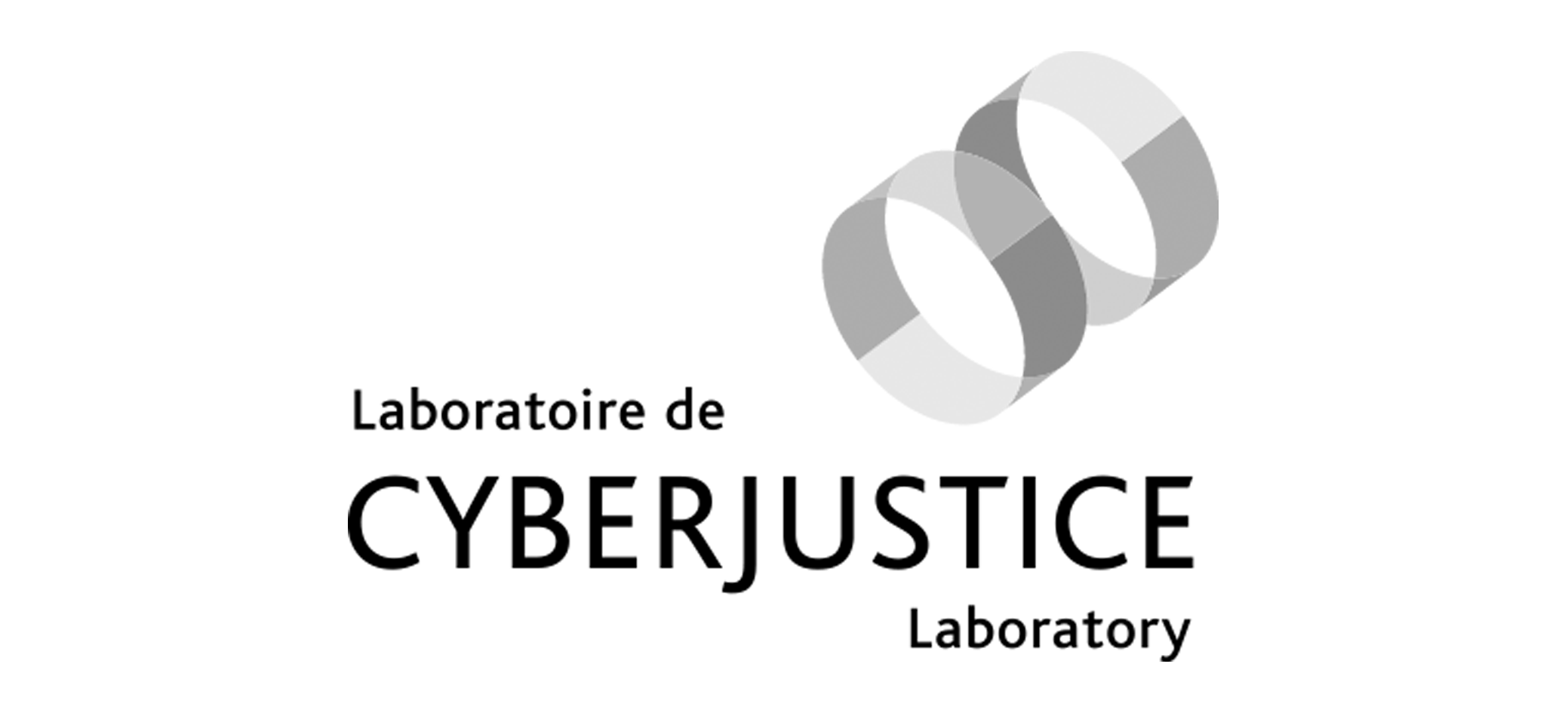Loi Waserman du 21 mars 2022 : la protection des lanceurs d’alerte
La loi Waserman est la transposition en droit français de la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte, adoptée en 2019 par le Parlement européen : un texte visant à renforcer les mesures de protection pour les personnes qui signalent des violations des droits.
À l’échelle européenne comme nationale, ce cadre légal a pour but d’harmoniser et de clarifier les droits des lanceurs d’alerte, considérés comme des piliers essentiels de toute société fondée sur l’ouverture, la transparence et la confiance. Il a également pour objectif de donner aux organisations les moyens de détecter les violations à un stade précoce afin de prévenir ou de minimiser les dommages potentiels, en instaurant une procédure de contrôle rigoureuse.
Qu’est-ce que la loi Waserman ?
Promulguée le 21 mars 2022, la loi Waserman ne se contente pas de transposer la directive européenne : elle va plus loin. Pour ce faire, elle modifie le dispositif général de protection des lanceurs d’alerte et corrige certaines des limites de la loi Sapin 2, mises en évidence par un rapport sur l’évaluation de l’impact de ce texte en juillet 2021.
Ce que la loi Waserman apporte à la loi Sapin 2
La loi Sapin 2, adoptée en 2016, avait donné le ton en imposant un ensemble de mesures pour renforcer la transparence et lutter contre la corruption dans la sphère publique comme dans la sphère privée. La loi Waserman va plus loin en consolidant les droits des salariés et des agents de la fonction publique qui signalent des faits tombant sous le coup de la réglementation.
Ce texte renforce les garanties de confidentialité entourant les signalements des lanceurs d’alerte en complétant la liste des représailles interdites, telles que l’intimidation, les atteintes à la réputation sur les réseaux sociaux ou l’orientation abusive vers des soins. Elle étend l’irresponsabilité des lanceurs d’alerte pour les préjudices causés par leur signalement de bonne foi, tant sur le plan civil que pénal.
Par ailleurs, la loi Waserman complète la liste des secrets applicables. Sont exclus du champ d’application du texte les « faits, informations ou documents […] couverts par le secret des délibérations judiciaires, de l’enquête et de l’instruction », au même titre que le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre l’avocat et son client.
La loi Waserman vise également à réduire le coût financier des procédures engagées par les salariés qui révèlent des violations. En début de procès, le juge peut accorder une provision pour les frais de justice du lanceur d’alerte qui conteste des mesures de représailles visant à le réduire au silence.
Le texte prévoit aussi des mesures de soutien psychologique et financier pour les lanceurs d’alerte, qui peuvent être accordées par une autorité externe ou par le Défenseur des droits. Le Sénat a également apporté des ajustements afin d’aligner la protection des militaires lanceurs d’alerte sur celle des fonctionnaires civils, renforçant ainsi leur protection dans divers secteurs.
Enfin, de nouvelles sanctions ont été mises en place : les représailles engagées à l’encontre d’un lanceur d’alerte sont désormais considérées comme un délit pénal. Leur auteur risque jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
La directive européenne du 23 octobre 2019 sur les lanceurs d’alerte
La directive européenne, initiée par la Commission avant d’être soumise au Parlement, établit des normes minimales communes pour la protection des lanceurs d’alerte dans les pays de l’Union.
En vertu de ce texte, les lanceurs d’alerte sont protégés lorsqu’ils signalent des faits illégaux, des actes de corruption ou des violations du droit de l’Union dans dix domaines : marchés publics, sécurité des transports, protection de l’environnement, RGPD, atteintes aux intérêts financiers de l’Union ou encore violations relatives au marché intérieur.
Le statut de lanceur d’alerte s’applique aussi bien aux personnes ayant une relation de travail avec l’organisation concernée (salariés ou agents) qu’à celles qui n’en ont pas ou plus. La directive fournit également une liste des représailles interdites, comme la résiliation anticipée d’un contrat pour les entités juridiques associées aux personnes ayant révélé des faits répréhensibles.
Tous ces éléments ont été repris dans la loi Waserman, qui transpose dans le droit français le contenu de la directive européenne. Ce faisant, le texte complète efficacement les mesures déjà imposées par la loi Sapin 2.
L’élargissement des obligations pour les entreprises
La loi Waserman étend le périmètre des personnes protégées aux facilitateurs : les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte ainsi que les entités juridiques contrôlées par ce dernier. La France est ainsi le premier pays européen à reconnaître ce statut, qui joue un rôle majeur aux côtés des lanceurs d’alerte.
Elle élargit également la définition du lanceur d’alerte. Alors que la loi Sapin 2 limitait ce statut aux salariés ayant des liens directs avec l’organisme privé ou public concerné, le nouveau texte l’étend à toute personne ayant eu accès à des informations, même sans en avoir personnellement connaissance.
La loi supprime aussi la notion ambiguë de « désintéressement » : la preuve d’absence de contrepartie financière directe suffit désormais.
Enfin, la loi Waserman agrandit le périmètre des sanctions interdites. À titre d’exemple, un lanceur d’alerte ne peut pas être sanctionné par la résiliation du contrat passé avec l’entité juridique qu’il contrôle.
Se mettre en conformité
Qui est concerné par la loi Waserman ?
La loi Waserman concerne les organisations publiques et privées. Dans le détail, le texte s’applique :
- Aux organisations publiques ou privées comptant au moins 50 employés.
- Aux organisations publiques comptant au moins 10 000 habitants.
Les entreprises de moins de 50 salariés (TPE et PME) ne sont pas directement concernées par les obligations de la loi Waserman. Néanmoins, ces organisations sont encouragées à adopter les recommandations du texte pour protéger leurs salariés et renforcer la transparence.
Timeline de la loi Waserman
- Avril 2019 : approbation de la directive par le Parlement européen.
- 23 octobre 2019 : adoption de la directive (UE) 2019/1937 pour la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union.
- 21 juillet 2021 : dépôt de la proposition de loi Waserman par le député Sylvain Waserman.
- 17 novembre 2021 : adoption par l’Assemblée nationale.
- 16 décembre 2021 : entrée en vigueur pour les entreprises de plus de 250 salariés.
- 20 janvier 2022 : adoption par le Sénat.
- 16 février 2022 : adoption définitive par le Parlement.
- 21 mars 2022 : promulgation de la loi n° 2022-401, dite « loi Waserman ».
- 1er septembre 2022 : entrée en vigueur pour les entités privées de plus de 50 salariés et les collectivités de plus de 10 000 habitants.
- 3 octobre 2022 : adoption du décret d’application (en vigueur le 5 octobre).
Sylvain Waserman : l’homme derrière la proposition de loi
Peu connu du grand public, Sylvain Waserman est à l’origine de la proposition de loi portant son nom. Ancien député MoDem du Bas-Rhin et ex-maire de Quatzenheim, il a été vice-président de l’Assemblée nationale en 2017 et rapporteur de la réforme du règlement de l’Assemblée.
En 2019, il rédige deux propositions de loi transposant en droit français la directive européenne sur les lanceurs d’alerte, adoptées par le Parlement. En 2023, il devient président du conseil d’administration de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), et quitte son activité de conseil en stratégie.
Les effets de la loi Waserman sur les entreprises et les collectivités
En prolongeant et en corrigeant certains points de la loi Sapin 2, la loi Waserman permet aux organisations de mieux protéger les lanceurs d’alerte et de se doter de processus de signalement et de traitement plus efficaces.
Elle renforce la gouvernance interne, la conformité et la culture de transparence au sein des entreprises et des collectivités, en imposant la mise en place de dispositifs de recueil, d’analyse et de suivi des signalements assortis de garanties de confidentialité, de protection contre les représailles et d’accompagnement des lanceurs d’alerte.
En plaçant la gestion des alertes au cœur des politiques éthiques et de conformité, la loi Waserman consolide la responsabilité organisationnelle et la confiance au sein des institutions.
L’élargissement des mesures de protection pour les lanceurs d’alerte
De manière schématique, la loi Sapin 2 empêchait l’organisation de prendre une sanction contre le lanceur d’alerte – blâme ou licenciement, notamment. Aujourd’hui, la loi Waserman protège tous les aspects de la relation contractuelle (et de la vie professionnelle) de l’employé avec son organisation, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une collectivité publique.
Contrat de travail
Poste de travail
Evolution de carrière
Position dans l'entreprise
Position dans le secteur d'activité
Relation contractuelle
Professionnels, pour gérer vos alertes professionnelles, choisissez le service Alertcys.io
Quelle procédure suivre pour mettre en place un dispositif conforme ?
Dans le cadre de la loi Waserman, l’organisation est dans l’obligation de renforcer son dispositif de signalement en mettant l’accent sur la confidentialité et sur l’impartialité. Or, le texte donne la possibilité au lanceur d’alerte de choisir entre le signalement interne d’un côté, et le signalement externe de l’autre – auprès de l’autorité compétente, du Défenseur des droits, de la justice ou de tout autre organe européen. Avec le risque, pour l’organisation, d’une divulgation publique des faits ou des actes (seulement dans certaines situations).
En pratique, l’entreprise a donc tout intérêt à mettre en place un dispositif d’alerte interne efficace, sécurisé et crédible, et à garantir un suivi irréprochable du traitement des alertes. Cela, afin d’encourager les salariés à se tourner naturellement vers ce canal de signalement qui protège les intérêts de l’organisation.
Les bonnes pratiques pour une mise en œuvre réussie de la loi Waserman
La mise en œuvre d’une procédure de signalement ne se limite pas à la création d’une adresse email dédiée. L’organisation doit informer ses salariés sur le dispositif, les former à son utilisation et leur apporter des informations concrètes sur ce sujet : ce qu’est une alerte, comment fonctionne la protection du lanceur d’alerte, quels faits peuvent être signalés (actes de corruption, violations de la loi, comportements contraires à l’éthique, etc.). Elle doit aussi choisir un dispositif qui protège les lanceurs d’alerte par design.
Formation et communication au sein de l’entreprise
La formation et la communication au sein de l’organisation privée ou publique sont des piliers essentiels pour garantir le succès de tout processus de signalement inspiré par la loi Waserman. Ces deux aspects contribuent à créer une culture d’entreprise axée sur l’éthique, la transparence et la prévention de la corruption.
- Formation des employés : il est crucial de mettre en place des programmes de formation réguliers pour sensibiliser les salariés à l’importance du signalement des actes répréhensibles. Ces formations doivent être adaptées aux différents niveaux hiérarchiques et aux fonctions de l’entreprise. Elles doivent inclure des exemples concrets et des scénarios pour aider les salariés à identifier les comportements problématiques : faits de violations de la loi, actes de corruption, etc.
- Communication au sein de l’organisation : une communication efficace est nécessaire pour informer les employés des canaux de signalement disponibles et des garanties de confidentialité. L’entreprise doit encourager une culture où les salariés se sentent libres de signaler des actes répréhensibles sans crainte de représailles. Cela peut se faire à travers des réunions, des affichages dans les locaux, des circulaires internes, des bulletins d’information et des supports en ligne.
Nous pouvons vous faire profiter de notre expérience sur ces sujets : n’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Promouvoir une culture de confiance
Promouvoir une culture de la confiance au sein de l’organisation est une étape cruciale pour assurer le succès du processus de signalement. Cette culture repose sur plusieurs principes fondamentaux :
- Transparence et ouverture : la culture de la confiance s’édifie sur une base de transparence. L’entreprise doit être ouverte quant à ses pratiques, ses valeurs et son engagement envers l’éthique et la conformité. Cela signifie communiquer de manière claire sur les procédures de signalement, les garanties de protection des lanceurs d’alerte et les mesures prises pour prévenir la corruption. Nous vous encourageons à rédiger une charte éthique qui reprend vos valeurs.
- Leadership éthique : les dirigeants et cadres doivent montrer l’exemple en adoptant des comportements éthiques et en soutenant activement la procédure de signalement. Leur engagement en faveur de l’éthique et de la conformité renforce la confiance des salariés dans le processus.
- Encourager le signalement : les employés doivent se sentir en confiance pour signaler des actes répréhensibles ou des violations de la loi. L’organisation doit favoriser cette démarche en créant un environnement dans lequel les lanceurs d’alerte sont protégés, respectés et valorisés pour leur intégrité. En ce sens, il est nécessaire de choisir un service de signalement qui inspire la confiance.
- Communication régulière : une communication récurrente sur les progrès réalisés en matière d’éthique et de conformité renforce la confiance des salariés. Cela peut inclure des rapports d’activité sur les signalements, les mesures prises en réponse et les sanctions appliquées en cas de violation.
- Sanctions en cas de violations : l’impunité tend à saper la confiance. L’entreprise doit être prête à prendre des mesures disciplinaires en cas de manquement à l’éthique ou à la conformité. C’est une manière d’envoyer un message clair : les comportements répréhensibles ne seront pas tolérés.
Sanctions en cas de représailles : que risque l’employeur ?
Les entreprises qui ne protègent pas suffisamment les lanceurs d’alerte ou qui mettent elles-mêmes en place des représailles contre les salariés ayant révélé des actes répréhensibles sont passibles de sanctions. De fait, la loi Waserman a élargi la liste des représailles interdites et l’étendue de la responsabilité civile et pénale.
Concrètement, l’auteur des représailles au sein de l’organisation est passible d’une amende de 60 000 € (le montant a été doublé par rapport à la loi Sapin 2) et de 3 ans d’emprisonnement. Il est également prévu que le lanceur d’alerte puisse bénéficier d’une provision pour les frais de justice en cas de représailles ou de procédure-bâillon.
Découvrez notre service conforme à la loi Waserman
La loi Waserman en synthèse : les points clés à retenir
La loi Waserman constitue une avancée majeure en matière de protection des lanceurs d’alerte. En traduisant dans le droit français la directive européenne de 2019, ce texte renforce les mesures de protection et introduit des obligations strictes pour les entreprises. Cela, dans le but de créer un environnement où les comportements illégaux (faits de corruption, violations du droit, etc.) peuvent être signalés sans crainte de représailles.
Quels sont les points à retenir ?
- Une définition élargie du lanceur d’alerte : la loi Waserman élargit la définition du lanceur d’alerte pour inclure toute personne physique qui signale ou divulgue des informations de bonne foi et sans contrepartie financière directe. Le texte couvre également un éventail plus large d’incidents, d’actes et de faits.
- Une protection accrue pour les lanceurs d’alerte : le texte renforce la protection des lanceurs d’alerte avec des mesures telles que la protection contre les représailles, des garanties de confidentialité et des dispositions pour le signalement anonyme. Elle protège le lanceur d’alerte dans tous les aspects de sa vie au sein de l’organisation.
- Des procédures de signalement plus rigoureuses : la loi Waserman définit des procédures pour le signalement interne et externe des alertes, avec des dispositions spécifiques pour les structures des entreprises et des organismes publics. Dans certains cas, elle permet la mutualisation de la procédure. Le lanceur d’alerte peut aussi choisir son canal de signalement et, sous certaines conditions, divulguer publiquement des faits répréhensibles tout en bénéficiant du statut protecteur (notamment si le canal interne n’aboutit pas ou en cas de danger grave et imminent).
- Une disposition plus stricte relative aux sanctions : la loi prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations relatives à la protection des lanceurs d’alerte. Le montant de l’amende civile est porté à 60 000 €, avec des peines complémentaires possibles d’affichage ou de diffusion de la décision de justice.
- Un rôle plus actif pour l’autorité compétente : le rôle du Défenseur des droits (ou d’autres autorités compétentes) est clarifié pour assurer le respect de la loi. Ces autorités peuvent accorder un soutien psychologique ou financier pour accompagner le lanceur d’alerte dans sa démarche.
Nos partenaires de confiance
FAQ : loi Waserman et protection des lanceurs d’alerte
Quelles différences entre la loi Sapin 2 et la loi Waserman ?
La loi Waserman vient compléter la loi Sapin 2 et corriger certaines de ses limites. Elle donne une définition plus large du lanceur d’alerte, crée le statut de facilitateur et supprime la hiérarchie des canaux de signalement, permettant ainsi aux salariés de choisir le canal qui leur convient.
Le texte prévoit également un meilleur suivi du traitement des alertes : le Défenseur des droits doit dresser chaque année un rapport sur les signalements reçus par les agences indépendantes. Il introduit de nouvelles sanctions en cas de représailles et une protection renforcée du lanceur d’alerte, couvrant tous les aspects de sa vie dans l’entreprise.
Quels types d’organisations doivent appliquer la loi Waserman ?
La loi Waserman s’applique à toutes les organisations privées ou publiques comptant au moins 50 salariés ou, pour les collectivités, au moins 10 000 habitants. Les entités ne remplissant pas ces critères sont néanmoins encouragées à mettre en place des dispositifs de signalement et de traitement des alertes conformes à l’esprit de la loi.
Quels canaux de signalement les entreprises doivent-elles mettre en place ?
Pour se conformer à la loi Waserman, les entreprises doivent mettre en place des canaux de signalement sécurisés et confidentiels permettant aux salariés (ou à toute autre personne concernée) de signaler des actes de corruption, des violations de la loi ou des comportements contraires à l’éthique. Ces canaux peuvent prendre différentes formes : adresse email dédiée, ligne téléphonique spécifique ou plateforme d’alerte professionnelle sécurisée.
Quels sont les délais pour traiter un signalement interne ?
Le décret du 3 octobre 2022 (article 4) prévoit que le lanceur d’alerte soit informé par écrit de la bonne réception du signalement dans un délai de 7 jours ouvrés. Ensuite, l’entité doit lui communiquer par écrit les mesures envisagées ou prises dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’accusé de réception (ou de l’expiration du délai de 7 jours ouvrés après le signalement). Si les allégations sont infondées ou sans objet, le traitement est clôturé.
Comment une entreprise de plus de 50 salariés doit-elle se préparer à la loi Waserman ?
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre en place une procédure de signalement confidentielle et sécurisée. Ce processus doit permettre aux salariés ou à toute personne extérieure intéressée de signaler des faits de violation de la loi, tels que des actes de corruption ou des manquements à l’éthique.
Quels sont les risques liés à la loi Waserman ?
En marge des avancées permises par la loi Waserman, certains risques doivent être pris en compte par les organisations :
- Risques d’interprétation : les notions de « bonne foi », d’« absence de contrepartie financière directe » ou de « danger grave ou imminent » peuvent donner lieu à des interprétations variées selon les juges, créant une incertitude juridique pour les lanceurs d’alerte.
- Faits exclus du champ de protection : certains secrets restent hors du champ d’application : défense nationale, délibérations judiciaires, instruction, secret médical, ou secret des relations entre avocat et client. Le lanceur d’alerte peut donc être exposé s’il révèle des informations protégées.
- Facteurs internes à l’organisation : la culture d’entreprise, la hiérarchie ou les tensions internes peuvent décourager le signalement malgré la protection légale existante.
Ressources complémentaires
- Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union
- Loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (loi Waserman)
- Proposition de loi présentée à l’Assemblée nationale (21 juillet 2021)
- Décision du Conseil constitutionnel (17 mars 2022)
- Décret du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte